Risque ramulariose sur orges d’hiver : ne pas attendre les symptômes pour traiter
La ramulariose est une maladie fongique de l’orge très présente depuis deux ans dans le sud-ouest. Selon cet historique, le risque pourrait être à nouveau élevé cette année. Sur quelle stratégie fongicide se baser ?

On reconnaît la ramulariose à ses « taches léopard », petites taches brunes entourées d’un halo jaune (chlorose) qui apparaissent sur les étages supérieurs autour du stade épiaison généralement. Cette maladie se transmet par le biais de contaminations externes mais surtout par le biais des semences.
Quand traiter ?
Le traitement fongicide pour viser la ramulariose se positionne lors du T2. Si un T1 a été réalisé, le T2 peut s’envisager au stade sortie des barbes. En revanche, en cas de traitement unique, il peut s’envisager plutôt au stade dernière feuille étalée. Ne pas attendre de voir les premiers symptômes de ramulariose pour déclencher le traitement, car une fois que les premières taches apparaissent, la maladie se développe très rapidement ; la senescence totale des feuilles/plantes peut prendre seulement quelques jours (photos).

Attention à ne pas trop anticiper non plus le traitement et attendre que la dernière feuille soit bien sortie pour garantir la couverture de cette dernière. Les essais conduits par ARVALIS l’an passé ont montré une bonne efficacité des programmes associant du mefentrifluconazole + prothioconazole, ainsi que du folpel.
Tableau 1 : Quelques propositions de programmes fongicides contre la ramulariose sur orges

Quelques éléments de biologie sur la ramulariose
Les symptômes de la ramulariose se confondent souvent avec les grillures et les petites taches d’helminthosporiose en fin de cycle. Ses petites taches brunes traversent la feuille (contrairement aux grillures, qui se retrouvent généralement sur la partie supérieure de la feuille uniquement) et présentent des alignements de bouquets blancs (conidiophores) dans le sens des nervures (visible à la loupe binoculaire), sur les taches les plus nécrosées. Attention aux confusions avec l’helminthosporiose qui possède, quant à elle, des conidiophores en forme de « poils noirs ».
Figure 1 : Clé de détermination pour valider le diagnostic de ramulariose

Le développement de la ramulariose est asymptomatique en début de cycle. Cela signifie que, même lorsqu’elle est présente dans la plante, la maladie ne s’exprime, au travers de symptômes, qu’à partir de la floraison généralement (concordant avec l’apparition de stress nutritionnel et/ou environnementaux). La production d’une toxine spécifique va alors avoir lieu à ce moment-là. Cette toxine en question, la rubelline, est phytotoxique mais surtout photosensible. Donc une fois activité par la lumière, elle va détruire très rapidement les parois cellulaires et va accélérer la senescence des feuilles. La plante va dessécher dans un pas de temps très court et cela du haut vers le bas, le haut de la plante étant davantage exposée aux rayonnements solaires et donc à l’activation de la toxine. On observe dans les cas les plus extrêmes une dessication accélérée des parcelles en quelques jours seulement.
Les autres facteurs de risques identifiés, qui semble prépondérant au développement de la maladie sont : l’hygrométrie importante notamment durant la période mai-début juin, l’excès d’eau/l’hydromorphisme, l’excès de rayonnement et les températures douces (15-25°C).





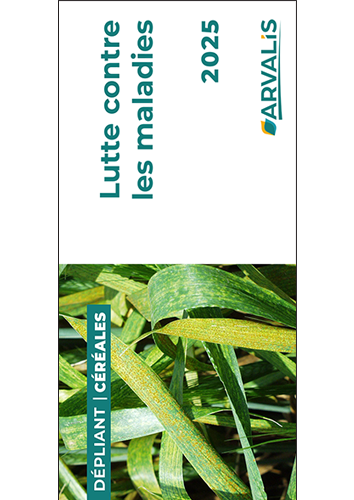

Réagissez !
Merci de vous connecter pour commenter cet article.