Stress climatiques et nutritionnels : quelques biostimulants tirent leur épingle du jeu
ARVALIS a testé sur blé une dizaine de biostimulants visant à améliorer son efficience d’utilisation des éléments minéraux ou sa tolérance aux stress climatiques. Il est cependant difficile de mettre en évidence des effets significatifs sur le rendement ou sur les critères de qualité en conditions de plein champ. Quant à leur rentabilité, elle est encore moins évidente.

Stimuler la photosynthèse, l’absorption ou l’utilisation des éléments minéraux prélevés par les cultures, ou renforcer leur tolérance face à des stress climatiques à des stades sensibles, voici quelques effets revendiqués par les fabricants de biostimulants (voir encadré).
Afin d’évaluer dans quelle mesure les biostimulants présents sur le marché peuvent effectivement agir sur ces processus physiologiques, ARVALIS a mis en place plusieurs réseaux d’essais.
Des réseaux d’essais menés en pluriannuel sur blé entre 2013 et 2023
Douze biostimulants revendiquant une amélioration de la tolérance aux stress abiotiques ont ainsi été évalués. La majorité d’entre eux ont été testés dans un réseau d’essais conduits par ARVALIS de 2021 à 2023 sur blé tendre d’hiver, mais quatre biostimulants ont été testés dans des essais plus anciens. C’est le cas de Kaïshi et Shigeki dont l’évaluation a démarré respectivement en 2019 et 2020, pour s’achever en 2022. AgrOptim Sunset, lui, a été testé dans un autre réseau d’essais, de 2018 à 2020, en partenariat avec d’autres structures. Parmi tous les essais dans lesquels ces trois produits ont été testés, l’un, en 2020, a été conduit en blé dur. Enfin, Appetizer a été évalué dans un réseau encore plus ancien, de 2013 à 2017 conduit avec plusieurs partenaires et incluant trois essais blé dur.
Ainsi, selon leur année de mise sur le marché et leur disponibilité, les douze biostimulants n’ont pas été testés simultanément dans les mêmes essais. Chaque produit a été appliqué selon les préconisations de son metteur en marché. Pour certains biostimulants, les recommandations ne portent pas sur un stade d’application précis mais plutôt sur un positionnement par rapport à une période de stress. Cela peut être soit en prévision d’un stress à venir (cas de Shigeki et du principe actif Aminovital), soit lors de son apparition comme dans le cas de Kaïshi. Dans ces cas de figure, un même produit a pu être appliqué à des stades différents d’un essai à l’autre. Pour toutes ces raisons, les différents produits testés dans ces essais n’ont pas été confrontés exactement aux mêmes conditions de stress, ne permettant pas de comparer les produits entre eux. Seul l’écart obtenu avec le témoin sans biostimulant peut être facilement interprété (tableau à télécharger).
Seulement quelques produits tirent leur épingle du jeu
Le gain apporté sur le rendement ou la teneur en protéines reste limité. Sur douze produits testés, seuls deux présentent des effets significatifs. Appetizer permet en moyenne un gain de rendement de 1,1 q/ha par rapport au témoin, sans effet de dilution de la protéine, tandis que Labin Energy Grow n’apporte pas de gain de rendement mais améliore la teneur en protéines de 1,4 point.
Il faut noter que ces produits revendiquent une amélioration de l’absorption et de l’efficience d’utilisation des éléments nutritifs et notamment de l’azote. Aucun des produits visant uniquement à améliorer la tolérance des cultures vis-à-vis des stress climatiques n’a eu d’effet dans ces essais.
Un coût d’application difficilement rentabilisé
Au-delà des performances techniques, il est essentiel de tenir compte du retour sur investissement de ces produits. À noter que l’approche économique proposée ici a été réalisée sur la base des résultats bruts des essais, indépendamment de la significativité statistique des différences de performances par rapport au témoin.
Sur blé tendre
Sur blé tendre, dans un contexte économique très favorable avec un cours du blé élevé à 285 €/t et un prix d’achat des biostimulants faible de l’ordre de 15 €/ha, un gain de rendement de 0,5 q/ha permettrait de rentabiliser l’investissement. Dans cette situation, seulement un peu plus de la moitié des biostimulants testés, en moyenne, sont rentables. Lorsque le contexte économique s’avère plus difficile (blé à 210 €/t ou moins et biostimulants à au moins 30 €/ha), aucun des produits testés ne donne alors, en moyenne, la garantie d’un retour sur investissement (tableau 1).
Tableau 1 : Seuil de rentabilité, en q/ha, des biostimulants en fonction de leur prix d’achat et du prix de vente du blé tendre

Valeurs entre parenthèses : nombre de biostimulants sur les douze testés pour lesquels, en moyenne, le seuil de rentabilité est atteint.
(1) Charges de mécanisation liées à l’application du biostimulant non prises en compte car passage souvent couplé à une autre intervention (engrais, herbicide ou fongicide).
(2) enquête ARVALIS auprès des distributeurs et des fabricants.
(3) Observatoire prix ARVALIS, Terre net, IPAMPA.
Sur blé dur
Sur blé dur, dans un contexte économique très favorable avec un cours du blé élevé à 400 €/t et un prix d’achat des biostimulants faible de l’ordre de 15 €/ha, un gain de rendement de 0,4 q/ha permettrait de rentabiliser l’investissement. Dans cette situation, deux-tiers des biostimulants testés, en moyenne, sont rentables. Lorsque le contexte économique s’avère plus difficile (blé dur à 250 €/t et biostimulants à 30 €/ha ou blé dur à 340 €/t et biostimulants à 60 €/ha), aucun des produits testés ne donne alors, en moyenne, la garantie d’un retour sur investissement (tableau 2).
Tableau 2 : Seuil de rentabilité, en q/ha, des biostimulants en fonction de leur prix d’achat et du prix de vente du blé dur

Valeurs entre parenthèses : nombre de biostimulants sur les douze testés pour lesquels, en moyenne, le seuil de rentabilité est atteint.
(1) Charges de mécanisation liées à l’application du biostimulant non prises en compte car passage souvent couplé à une autre intervention (engrais, herbicide ou fongicide).
(2) enquête ARVALIS auprès des distributeurs et des fabricants.
(3) Observatoire prix ARVALIS, Terre net, IPAMPA.
Une réponse ponctuelle et dépendante de l’état de la plante et des conditions environnementales
Quel que soit le principe actif utilisé, un biostimulant dont le mode d’action repose sur la modulation de certaines voies métaboliques de la plante agit comme une molécule « signal ». Il induit des réponses de la culture généralement hétérogènes d’une situation à l’autre.
En effet, la réponse sera plus ou moins intense selon l’importance du signal perçu et de sa modulation par l’environnement (climat, sol) et de l’état de la plante. Ces sources de variation expliquent que l’effet d’un biostimulant ne soit pas le même partout, à dose et stade d’application identiques.
Par ailleurs, cette stimulation reste bien souvent ponctuelle : elle s’estompe au bout de quelques jours voire quelques semaines. Sur céréales, les biostimulants sont - le plus souvent - appliqués une à deux fois au cours du cycle. La persistance dans le temps de leurs effets sur l’activité physiologique de la plante est donc capitale pour qu’un bénéfice puisse s’exprimer.
Dans leur grande majorité, les produits mis sur le marché ont dû justifier de leur efficacité vis-à-vis des effets revendiqués pour obtenir leur homologation ou l’attestation de conformité au règlement européen. Cependant, il suffit que cette efficacité ait été validée dans quelques situations et non pas dans toute la diversité de conditions pédoclimatiques et d’états physiologiques des cultures rencontrés au champ. De nombreux facteurs tels que le contexte pédologique et les aléas climatiques peuvent ainsi expliquer que l’expression des effets attendus n’est pas toujours au rendez-vous ; et même quand elle l’est, qu’elle ne se traduit pas systématiquement par un gain de rendement ou l’augmentation de la teneur en protéines.
Lire aussi : « Biostimulants : de quoi parle-t-on ? »
Dans la pratique, ces produits sont le plus souvent associés à une application d’herbicide ou à un traitement fongicide afin d’économiser un passage. Cette stratégie ne permet pas forcément de positionner les biostimulants au moment où ils seraient les plus efficaces.
Il est donc nécessaire que les fabricants poursuivent leurs efforts pour mieux caractériser les situations dans lesquelles leurs biostimulants obtiennent les meilleurs résultats, notamment en termes d’état physiologique de la culture et de conditions climatiques. Ceci leur permettrait de mieux définir les conditions optimales d’utilisation de ces produits, et celles dans lesquelles il est peu probable d’obtenir un effet. L’étape suivante sera alors de proposer des indicateurs fiables voire des outils d’aide à la décision permettant de déterminer si ces conditions sont réunies afin de pouvoir décider ou non de l’utilisation du biostimulant en fonction du contexte.
Cependant, anticiper les stress climatiques restera toujours difficile, ce qui rend relativement délicat le positionnement de certains biostimulants à appliquer en préventif.
Les modes d’action des biostimulants s’appuient sur des processus physiologiques complexes. C’est le cas notamment pour les produits visant à stimuler les processus de nutrition par une meilleure efficacité d’absorption et/ou d’utilisation des éléments minéraux prélevés par les cultures.
C’est également le cas des biostimulants visant à renforcer la tolérance des plantes face aux stress abiotiques tels que le gel ou de faibles températures à des stades sensibles de la culture, le stress hydrique, les fortes chaleurs, un rayonnement déficitaire ou excédentaire… Ces situations peuvent être sources de stress oxydatif pour les cultures et provoquer une réduction de leur activité photosynthétique et donc de leur croissance.
Certains biostimulants visent avant tout à réduire l’impact direct de ces stress sur l’activité physiologique des plantes. C’est le cas par exemple des produits apportant des anti-oxydants (comme Revolt Céréales) ou des substances comme la proline ou la glycine bétaïne que l’on retrouve dans certains biostimulants visant spécifiquement à améliorer la tolérance au stress hydrique. Ces produits peuvent être appliqués suite à un stress ou, au contraire, en prévention de ces derniers. Certains principes actifs peuvent ainsi induire, selon les fabricants, un phénomène qui va accélérer par la suite l’induction des mécanismes de réaction au stress.
D’autres produits contiennent des molécules nécessaires à des activités métaboliques spécifiques que les plantes synthétisent en l’absence de stress, mais qui peuvent faire défaut lorsqu’elles activent leurs mécanismes de défense et ralentissent leur activité physiologique pour faire face à des conditions difficiles. L’apport de ces molécules serait alors perçu par la plante comme un signal de fin du stress.
Enfin, d’autres biostimulants visent à aider la plante à se remettre d’un stress, en accélérant la reprise de la croissance des plantes affaiblies par cette perturbation. Ce sont les produits contenant des sources d’énergie tels que les polysaccharides ou les acides aminés, mais aussi les produits contenant des principes actifs visant spécifiquement la stimulation de la photosynthèse et/ou des processus d’absorption ou d’utilisation des nutriments, comme le principe actif Go Activ, à base d’Ascophyllum nodosum, d’Appetizer (qui revendique une stimulation de la synthèse de la nitrate réductase et d’autres protéines impliquées dans le transport des éléments minéraux à l’intérieur de la plante et dans leur réallocation des organes végétatifs vers les grains).





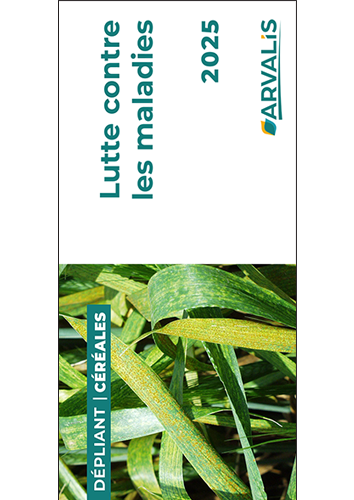

Réagissez !
Merci de vous connecter pour commenter cet article.