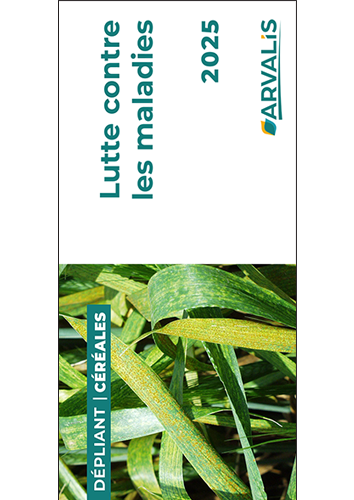La fonte des semis menace les maïs et les épinards bretons : la R&D se mobilise
En Bretagne, les problèmes de fonte des semis sur les cultures de maïs et d’épinard augmentent depuis que plusieurs fongicides utilisés pour traiter les semences ont été interdits. Le projet Fontsem est né pour mieux qualifier les pathogènes responsables, déterminer les facteurs de risque et identifier des moyens de protection.

Avant 2021, les maïsiculteurs bretons n’avaient probablement jamais entendu parler du champignon Pythium spp. Mais l’arrêt de traitement de semences, notamment du thirame, a provoqué une recrudescence des fontes de semis. En cause, Pythium essentiellement, mais d’autres agents pathogènes responsables de la fonte des semis comme Fusarium spp. Les producteurs de légumes d’industrie, notamment d’épinards, sont également très concernés par cette problématique.
Plus de 20 % de pertes de pieds en maïs
Bien que pour l’heure localisée essentiellement en Bretagne et dans le sud-Ouest, des régions intégrant des légumes d’industrie, la fonte des semis n’est pas une maladie à prendre à la légère. Les pertes de peuplement qu’elle occasionne en maïs atteignent parfois plus de 20 % (voire plus de 50 % dans les cas extrêmes), et entraînent des coûts de resemis qui dégradent la rentabilité de la culture.
Sur maïs (grain ou fourrage), une gamme de symptômes peut indiquer la présence potentielle de la fonte des semis, ce qui complique parfois le diagnostic. Par exemple : soit la graine ne germe pas, soit elle germe mais la plantule ne lève pas, soit elle lève mais le pied est si chétif qu’il est rapidement bloqué dans son développement. Aujourd’hui, il est encore difficile d’établir un lien entre ces symptômes sur plantes et la présence quantitative de Pythium spp dans le sol. Ce manque de références a donné naissance début 2024 à Fontsem1, un projet de recherche piloté par l'interprofession française des légumes en conserve et surgelés Unilet, et dans lequel ARVALIS, le groupe coopératif Eureden et l’Inrae sont associés.
Un réseau de parcelles pour mieux comprendre les attaques
Fontsem a pour objectif d’acquérir des connaissances sur les facteurs agro-climatiques qui influencent la maladie. Un réseau de parcelles cultivées permet à la fois de collecter des données sur le sol, les pratiques culturales et les conditions climatiques, ainsi que d’échantillonner des plantes symptomatiques.
Un focus sur la diversité microbienne du sol permettra ensuite de mieux comprendre les interactions entre la plante et les agents pathogènes pour objectiver les observations de terrain.
Un lien avec les cultures dans la rotation à confirmer
À la suite de cet état des lieux, les partenaires évalueront divers leviers agronomiques et phytosanitaires : substances actives encore homologuées, variétés, travail du sol, couverts d’interculture, irrigation, etc.
Pour cela, ils s’appuieront sur les résultats d’enquêtes menées auprès des agriculteurs qui possèdent les parcelles du réseau, afin d’identifier les pratiques qui seraient favorables au pathogène, notamment les cultures de la rotation. En effet, les observations et retours terrain suggèrent qu’un précédent légume favorise la fonte des semis dans les cultures de maïs. De même, des pluies significatives entre le semis et la levée semblent favorables aux attaques.
Enfin, 2026, dernière année du projet Fontsem, sera consacrée aux essais aux champs de combinaison des différents leviers de lutte identifiés dans la phase précédente.
1 D’une durée de trois ans, le projet Fontsem est financé par le Casdar Connaissances.
Justine GRAVE